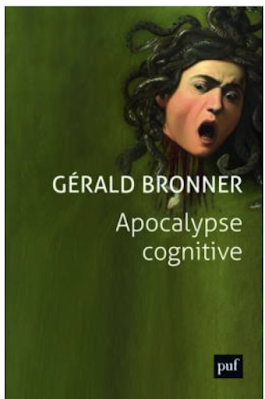vendredi 29 janvier 2021
mercredi 27 janvier 2021
Pascal Picq : "s'adapter ou périr"
"Les enseignements de la pandémie de Covid-19 au révélateur de sa science anthropologique, mais aussi de ses convictions et de ses engagements d'Homme : voilà les trésors que partage Pascal Picq dans ce dense dialogue, qui met comme jamais en lumière les attributs de "l'évolution" : plus que jamais, en effet, à l'épreuve de l'événement sanitaire, économique, social, (géo)politique, entrepreneurial, qui frappe la planète, n'est-il pas capital de se placer en situation, en condition, en volonté de s'adapter ? Jamais autant qu'aujourd'hui n'a été espérée une "société évolutionnaire", jamais autant qu'aujourd'hui n'est apparue aussi cardinale la conscience que chaque décision, chaque acte accompli maintenant détermine le "jeu des possibles" des générations futures. Oui, il s'agit bien de s'adapter. Ou de prendre le risque de disparaître." Denis Lafay.
mardi 26 janvier 2021
Boris Cyrulnik : "Des âmes et des saisons", Ed. Odile Jacob
Notre culture a perdu la boussole, nous naviguons à vue, bousculés par les événements, errant là où le vent nous porte. Il nous faut reprendre un cap, car nous venons de comprendre que l’homme n’est pas au-dessus de la nature, n’est pas supérieur aux animaux, il est dans la nature. La domination, qui a été une adaptation pour survivre, aujourd’hui ne produit que du malheur.
Une étoile du berger nous indique cependant la nouvelle direction, vers l’unité de la Terre et du monde vivant. » B. C.
Mike Horn : Pionnier de la révolution verte
Dakar: Mike Horn, pionnier de la révolution verte
INFOGRAPHIE - Avec Cyril Despres, quintuple vainqueur du rallye-raid, l’aventurier veut s’imposer en 2023 au volant d’un bolide à hydrogène.
La 43e édition du Dakar s’est élancée samedi de Djeddah pour une aventure de deux semaines, jusqu’au 15 janvier, dans le désert saoudien. L’épreuve reine du rallye-raid n’a, une nouvelle fois, pas échappé aux critiques de ses détracteurs dénonçant inlassablement l’impact carbone engendré par les 296 véhicules au départ (contre 342 l’an passé) et s’apprêtant à avaler 7 645 km de piste dans un pays, en plus, pointé du doigt pour ses infractions répétées aux droits de l’homme.
Sur le volet environnemental, au moins, les organisateurs vont pouvoir frapper vite et fort pour faire taire les voix qui grondent. Pour rompre avec l’encombrante image de pollueur qui lui colle à la peau et qui a fait fuir une partie des sponsors, l’épreuve a lancé une vraie révolution verte. Après avoir vu naître quelques projets de véhicules roulant aux énergies alternatives à faible émission, habiles mais éphémères coups de communication, Amaury Sport Organisation, propriétaire de l’épreuve, a ouvert la très ambitieuse page de l’hydrogène.
Ne nous y trompons pas, avec son barnum itinérant de 2 000 personnes, le Dakar ne pourra jamais être considéré comme une épreuve écologique. Mais, avec une flotte de véhicules à hydrogène rejetant uniquement de l’eau (et dans la mesure où le dihydrogène serait lui-même produit de manière propre, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui), le Dakar réduira considérablement son impact carbone à moyen terme. Cette conversion a déjà séduit Audi, qui a annoncé son retour sur l’épreuve, dès 2022, mais avec une technologie hybride en se servant du rallye-raid comme banc d’essai.
Deux projets «verts » ont aussi été lancés: celui de Guerlain Chicherit, baptisé «GCK e-Blast 1», basé sur un buggy Peugeot, et un autre, mené par la paire Cyril Despres-Mike Horn, «Gen Z». Leur but? Placer sur la ligne de départ de l’édition 2023 deux bolides à hydrogène.
Quelques jours seulement après avoir risqué sa vie dans une périlleuse traversée en Arctique en novembre 2019, l’aventurier Mike Horn avait accepté de participer au pied levé à l’édition 2020 en compagnie de Despres, quintuple vainqueur de l’épreuve à moto (entre 2007 et 2013). Un engagement en tant que copilote dans un buggy léger, peu polluant et bondissant à 120 km/h, qui avait placé l’explorateur sous le feu des critiques. «Ça changeait des grosses voitures qui roulent à fond, quand même, mais ce Dakar ne collait pas à mon image. Je m’en suis pris plein la figure, même si les gens ne savaient pas toutes les actions que je fais pour la planète. Mais j’ai écouté ce qu’on m’a dit», confie Horn.
Contraints à l’abandon après sept étapes, les deux hommes avaient planché sur un autre défi, avec plus de sens. «Je ne voulais plus courir avec un team officiel et foncer à 200 km/h dans le désert. Je cherchais quelque chose de différent», confirme Despres, troisième en 2017 avec Peugeot, sur quatre roues, cette fois. «Avec les enjeux environnementaux actuels, le Dakar ne pourra pas continuer comme cela longtemps. Sinon, il est fini, mort!», tranche le natif de Johannesburg. L’idée d’un buggy à hydrogène s’est assez rapidement imposée, dès février, après discussion avec des ingénieurs. L’association avec le CEA (Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives) conclue en novembre a permis de donner un bon coup d’accélérateur au programme. «Nous sommes des compétiteurs et on ne voulait pas perdre sept à huit ans pour y arriver. Avec le soutien des meilleurs ingénieurs du CEA, cette voiture sera une réalité dans trois ans», assure Despres.
Pari assumé
Pour le moment, les deux hommes doivent se débrouiller sans le soutien d’un constructeur. Un pari assumé par l’aventurier au discours sans filtre. «Ça aurait été de toute façon compliqué avec des marques. Ce sont des structures tellement lourdes avec toute la merde qui tourne autour, le lobbying, le commerce… On est deux blaireaux soutenus par des boîtes d’ingénieurs très sérieuses», plaisante l’ancien animateur des émissions «The Island» et «À l’état sauvage» sur M6.
Mike Horn le sait: à terme, le soutien d’une marque sera indispensable pour accompagner l’ambitieux projet. Le duo doit d’abord faire ses preuves cette année avant de rêver plus grand, au volant d’une Peugeot 3008 DKR, une voiture à moteur thermique préparée par le Team Abu Dhabi Racing. Le CEA a placé à l’intérieur un boîtier de 5 kg qui recueillera des données scientifiques ensuite transmises au bureau d’ingénierie. L’objectif sera donc d’être à l’arrivée à Djeddah dans une quinzaine de jours avec un maximum de données pour préparer l’avenir. «Je vais quand même devoir freiner les ardeurs de Mike, qui veut toujours aller plus vite», prévient Despres, aussitôt repris par son compère et ami de longue date: «J’aurais pu rester dans ma zone de confort, mais ce n’est pas ma vision des choses. La participation me fait chier. Je ne veux pas juste exister, je veux vivre. Et pour vivre, il faut gagner et être dans la compétition.»
lundi 25 janvier 2021
Jacques Attali "L'histoire des médias"
Jacques Attali publie "Histoires des médias", chez Fayard. Une analyse dense, passionnante ... et apocalyptique.
Le livre de Jacques Attali est sortie en librairie mercredi 18 janvier. Une Histoire des médias. 5000 ans en 500 pages. Une somme aérée, fluide, très facile à lire. Un pavé qui fourmille de petites histoires dans la grande Histoire. Un ouvrage qui nous rappelle, à sa manière, que les médias sont un peu le parent pauvre de l’université française. Les chercheurs qui s’y sont attelés le savent pertinemment. Ils sont un peu isolés et la matière ne paraît guère noble aux yeux de nos facultés. Les anglo-saxons, eux, ont compris depuis fort longtemps que la télévision ou encore les algorithmes, produisent le discours, façonnent l’imaginaire collectif, structurent nos rapports sociaux et constituent ainsi des terrains de réflexion riches, complexes, cruciaux pour penser nos sociétés. Jacques Attali s’est retroussé les manches. Je vous préviens. Son analyse, passionnante, n’est pas pessimiste, elle est apocalyptique.
vendredi 22 janvier 2021
Frédéric Lenoir : « Sages, mystiques et maîtres spirituels ».
Cette nouvelle édition compacte reprend l’ouvrage « Le livre des sagesses » paru en 2002, que j’avais dirigé avec Ysé Tardan-Masquelier. Il parcourt de manière chronologique l’aventure spirituelle de l’humanité du IVe millénaire av. J-C. jusqu’à nos jours, à travers des figures mystiques du monde entier et une anthologie de textes”. Frédéric https://www.fredericlenoir.com/…/sages-mystiques-et…/
Livre : Avec Jean-Claude Guillebaud, du cynisme à la douceur
ISTOCK
Entrer dans la douceur, telle est la proposition du journaliste et essayiste Jean-Claude Guillebaud dans son nouvel ouvrage (l'Iconoclaste). Comme un antidote à la folie du monde.
De l'aveu même de son auteur, ce nouvel essai est la suite naturelle - pour ne pas dire le complément ou le chapitre échappé - de son précédent ouvrage, Sauver la beauté du monde (l'Iconoclaste, 2019). C'est donc avec le plaisir d'une conversation réengagée que l'on se plonge dans ces pages écrites entre mars et septembre 2020, au coeur de la crise sanitaire mondiale liée au Covid-19.
Or, cet imprévu historique fait davantage résonner le propos du livre. Après une année 2020 durant laquelle nous aurons été plus que jamais bousculés par les cahots et les chaos du monde, notre propre sidération pourrait laisser place à une certaine résignation.
Souffle court, incrédule, qui ne s'est jamais laissé tenter par une forme de démission, tant il semble plus facile de se replier sur soi que de vouloir encore faire plier tous ceux qui imposent leurs idées, leurs fonctionnements, leur loi ? Jean-Claude Guillebaud dresse un diagnostic sans concession de ces folies confortablement installées aujourd'hui au coeur même de nos sociétés, de nos conversations et nos mentalités : esprit de compétition permanente, égoïsme triomphant, consentement aux inégalités et à la souffrance, paroles creuses ou expressions tellement usées qu'on en a perdu la saveur, cynisme satisfait de certaines élites politiques et médiatiques, nihilisme sourd...
Autant de maux que les lecteurs de La Vie ont l'habitude de voir épingler dans le Bloc-notes de notre hebdomadaire par le journaliste et essayiste chaque semaine. C'est donc en familiers que nous nous laissons guider par lui dans les pages d'écrivains et poètes qu'il affectionne, où il nous rappelle l'exemple de figures historiques, et même nous entraîne sur les chemins de Charente chers à son coeur, à la recherche d'un trésor perdu qui, seul, semble pouvoir réenchanter le monde.
« Voilà très longtemps que nous, Occidentaux, raisonnons à l'envers, écrit-il. Nous n'avons pas seulement oublié la douceur, nous l'avons congédiée. » Qu'est-ce, au fond, que la douceur ? De prime abord, le terme peut surprendre, et l'auteur s'en explique bien, jusqu'à justifier pourquoi il le préfère dans toute sa simplicité au mot de « tendresse » qu'affectionnait son ami le théologien Maurice Bellet. Car la douceur va au-delà du sentiment et de son expression ; elle irrigue tout l'être de celui qui l'accueille. Si elle est fragilité, elle n'est jamais faiblesse.
À travers l'exemple de deux Jeanne - Jeanne d'Arc et Joan Baez -, nous redécouvrons qu'elle demande plus de force que la violence, car elle est une force qui se contient elle-même. Jusqu'à - peut-être ? - se concentrer, comme on concentrerait une essence, dans l'expression même d'une forme extrême de délicatesse.
De page en page, Jean-Claude Guillebaud révèle à quel point cette idée peut nous renouveler, personnellement comme collectivement, en réveillant le meilleur de chacune et de chacun, ainsi que l'esprit d'entraide entre créatures qui est la seule vraie loi de la Création. Car tel est, sans doute, l'ultime secret que cet essai nous fait toucher - ou plutôt précautionneusement effleurer : avant toute chose, la douceur est relation.'
jeudi 21 janvier 2021
Henri-Pena Ruiz : Chronique intempestive
"Promouvoir le respect des principes de la République", par Henri Pena-RuizChronique intempestive
mercredi 20 janvier 2021
Cynthia Fleury - Etienne Klein : Panser 2020, Penser 2021 quel monde préparons-nous ?
Gaspard Koenig : L'Enfer
« C’est là que je réalisai toute mon erreur : je n’étais pas au Paradis, mais en Enfer. La torture éternelle, ce n’était pas la chaux et les pinces, mais un salon d’attente avec sièges inclinables. »
Un conte philosophique pour notre époque.
#Gaspard Koening #Littérature #Enfer
mardi 19 janvier 2021
Vincent Cespedes sur M6
2021 : le pari de l'humain
jeudi 14 janvier 2021
Joël de Rosnay « Petit éloge du surf »
Rétro 2020 : les livres de l'année
Joël de Rosnay, un des pionniers du surf en France, nous entraîne dans les "spots" du monde entier et nous plonge au coeur de ce qui l'a tant séduit dans le surf et qu'il connaît peut-être mieux que quiconque : l'esprit de la glisse.
Ed. François Bourin,
Ce livre figure parmi les "tops" des livres de l'année 2020
Chafles Pépin : La rencontre
Chères amies, chers amis,
Des rencontres entre nous il y en a eu beaucoup et elles ont fait ma joie. Nous nous sommes vus au MK2, en librairies, dans des cadres professionnels aussi, autour de bons dîners, et il y a un an nous étions ensemble au théâtre de la porte Saint-Martin. Ces rencontres ont été intenses, enthousiasmantes, chaleureuses, troublantes également. Elles m’ont fait avancer dans ma réflexion, dans mon questionnement. Mon nouveau livre La Rencontre, une philosophie, qui sort aujourd’hui en librairie est donc un peu le vôtre, il y a en lui beaucoup de ce que vous m’avez transmis. Parce que la rencontre des autres n’est pas un simple supplément mais le cœur d’une vie vraiment humaine, Parce que rencontrer quelqu’un c’est en même temps découvrir un monde et se redécouvrir, Parce que nous ne pouvons pas nous rencontrer aujourd’hui autant que nous le voudrions, mais que nous pouvons dès maintenant préparer les grandes rencontres de demain, je vous en confie avec émotion la lecture. Je serai heureux d’en parler avec vous dès que nous le pourrons. Charles Pépin
mercredi 13 janvier 2021
mardi 12 janvier 2021
Gérald Bronner - Philo Mag
Apocalypse cognitive
Une recension de Martin Legros, publié le
Préhistoire de l’attention
Selon le sociologue Gérald Bronner, la révolution numérique révélerait notre nature humaine la plus profonde, qui s’est construite durant la Préhistoire. Une hypothèse stimulante ou simpliste ?
Voici un essai aussi passionnant que déroutant. Avec un sens de la dramatisation argumentée, Gérald Bronner propose un diagnostic original sur la crise de notre temps. Elle tient moins à des problèmes objectifs, comme le réchauffement climatique ou la montée en puissance des régimes autoritaires, qu’à un ressort psychique : la bataille de l’attention. Jamais dans l’histoire, l’humanité n’a disposé d’un tel capital attentionnel. Avec la réduction massive du temps éveillé que nous consacrons au travail sur toute une vie – en France, il est passé de 48 % en 1800 à 11 % aujourd’hui –, l’humanité a gagné un temps libre considérable – le fameux « temps de cerveau humain disponible », selon la formule de Patrick Le Lay, le patron de TF1, à propos du capital que la chaîne vendait à ses annonceurs et que Bronner reprend à son compte sans jamais le citer, étrangement. « Ce temps libéré de notre esprit a été multiplié par plus de cinq depuis 1900 et par huit depuis 1800 ! Il représente aujourd’hui dix-sept années, soit près d’un tiers de notre temps éveillé. C’est un fait inédit et significatif dans l’histoire de l’humanité. »
Toute la question est de savoir ce que nous allons faire de cette précieuse ressource ? Allons-nous la consacrer à traiter collectivement les défis du moment, à base d’inventions scientifiques et technologiques, de partage des connaissances, de délibération démocratique et de régulation internationale ? Ou allons-nous la laisser se faire capturer par le marché dérégulé de l’information qui, à rebours de l’idéal d’émancipation des fondateurs de l’Internet, donne libre cours à nos penchants et favorise les biais cognitifs et le temps court ? À suivre Bronner, la balance penche du mauvais côté. Les informations qui nous captivent sont celles qui entretiennent nos peurs, confondent causalité et corrélation, relaient notre besoin de nous exhiber et de nous comparer, nous désinhibent de la violence et nous incitent à préférer les satisfactions immédiates du virtuel à la rude confrontation avec le réel.
Selon le sociologue, ce tableau clinique est une véritable « révélation ». D’où le terme d’« apocalypse cognitive » – apocalypse signifiant d’abord révélation d’une vérité cachée. Que révèle donc la dérégulation du marché de l’information ? Ni plus ni moins que… notre nature humaine la plus profonde, constituée par les structures de notre cerveau et les habitus cognitifs acquis durant la Préhistoire. Loin d’avoir « dénaturé » l’homme en le soumettant à des dispositifs aliénants, le capitalisme numérique ferait apparaître les invariants de la nature humaine que nous avons tendance à refouler. L’homme des clashs sur les réseaux sociaux, prêt à adhérer aux infox et aux thèses complotistes, c’est « l’homme préhistorique qui revient sur le devant de la scène ». Un homme à qui il faut réapprendre à « différer la satisfaction de ses désirs immédiats » et à « domestiquer l’empire de ses intuitions erronées ».
Si l’hypothèse est intéressante, on est stupéfait de l’anthropologie simpliste sur laquelle elle repose. Pour Bronner, l’homme préhistorique est en effet un homme tellement occupé à assurer sa subsistance dans un milieu hostile qu’il ne peut s’expliquer le fonctionnement de la nature qu’en peuplant le ciel de créatures enchantées avec lesquelles il doit négocier en permanence. Jusqu’au jour où surgit la raison qui lui permet de passer d’un rapport de soumission à un rapport de domination avec le monde. Marx ironisait sur les « robinsonnades » par lesquelles les philosophes du XVIIIe siècle se représentaient l’homme préhistorique. On est stupéfait qu’un sociologue français, qui ne peut ignorer les travaux sur la Préhistoire et l’ethnologie moderne, d’André Leroi-Gourhan à Claude Lévi-Strauss en passant par Pierre Clastres ou Philippe Descola, puisse se faire une image aussi rudimentaire de l’homme prémoderne et de ses croyances. Et quand Bronner nous annonce que « l’heure de la confrontation avec notre propre nature va sonner », on est séduits par l’hypothèse, mais on se demande où il a été cherché une image aussi frustre de Robinson.
lundi 11 janvier 2021
Webinar Sense Agency : Joel de Rosnay
Gérald Bronner : Apocalypse cognitive
Gérald Bronner est professeur de sociologie à l'Université de Paris, membre de l'Académie des technologies et de l'Académie nationale de médecine. Il a publié plusieurs ouvrages couronnés par de nombreux prix. Son dernier ouvrage paru est Cabinet de curiosités sociales (collection « Quadrige », Puf, 2020).
jeudi 7 janvier 2021
Gratte-ciel et voitures volantes, retour vers la ville du futur
Déjà au XIXe siècle, les métropoles du futur s'agitent, se déploient, s'activent sous terre et dans les airs. Dans ces villes fantasmées, il est possible de rouler, de voler, de glisser, ou de se reposer dans des jardins suspendus. Entre rêve et réalité, embarquement pour la ville du futur !

Architectones, Kasimir Malevitch, 1923-1929.
Les transformations techniques et sociales, le progrès des communications à la fin du XIXe siècle inspirent une nouvelle génération d’architectes, désireux de penser et de concevoir la ville du futur. Ces métropoles sont toujours le reflet des craintes, des rêves et des besoins des contemporains qui les imaginent. Tour à tour futuristes, fonctionnelles ou bucoliques, ces villes de demain sont au carrefour des innovations artistiques, architecturales et scientifiques de leur temps. Entre voitures volantes et immeubles de verre, elles se présentent tantôt comme un pur produit de l’imagination tantôt comme un projet de réforme des métropoles existantes.
Penser la ville du futur, c’est également imaginer la vie de demain. Les habitations occupent une place centrale dans ces anticipations. Les cuisines intelligentes, les maisons surélevées et les pièces largement ouvertes sur l’extérieur s’imposent bientôt dans les projets des architectes.
Yona Friedman imagine par exemple des villes spatiales, composées de modules d’habitation modifiables et transportables à l’infini, qui permettraient à leurs habitants de redevenir les maîtres et possesseurs de leur espace. Alors, vivons-nous aujourd’hui dans les villes imaginées pour nous par les hommes du passé et surtout que nous disent ces anticipations sur ceux qui les formulent ?
Avec Jean-Louis Cohen, architecte et historien de l’architecture et de l’urbanisme. Professeur invité au Collège de France depuis 2014 et professeur d'histoire de l'architecture à l'Institute of Fine Arts de la New York University, il a conçu et réalisé plusieurs expositions, parmi lesquelles Scènes de la vie future et Architecture en uniforme, au Centre Canadien d'Architecture de Montréal (1995 et 2011) et Le Corbusier, An Atlas of Modern Landscapes (2014) à Barcelone et Madrid. Il est par ailleurs l’auteur de nombreux ouvrages, notamment L'Architecture au futur depuis 1889 aux éditions Phaidon (2012) et Construire un nouveau Nouveau Monde, L’amerikanizm dans l’architecture russe (Éditions de la Villette, 2020).
Avec nous aussi, Caroline Cros, conservatrice du patrimoine, spécialisée en art du XXe et du XXIe siècle. Elle enseigne l’histoire de l’art contemporain à l’École du Louvre. Elle est l’auteure d’une thèse intitulée César, un primitif moderne, nouveaux éclairages sur les années 1960-1975. Elle est commissaire de l’exposition Yona Friedman / Architecture mobile = Architecture vivante à la Cité de l'Architecture en 2016 et co-réalisatrice avec Antoine de Roux du documentaire Animal normal : Conversations avec Yona Friedman 2007-2014 (2014).
1889,c'est la grande exposition qui célèbre à Paris le centenaire de la Révolution française avec la tour Eiffel, la galerie des machines, la féerie de l'électricité... Une exposition qui donne donc l'image de la grande ville transformée par les technologies nouvelles : l'acier, l'électricité, la chimie moderne. C'est cette ville que les architectes perçoivent comme devant irrévocablement se transformer pour entrer dans cet âge industriel. Jean-Louis Cohen
Peu avant le confinement, Yona Friedman a imaginé un nouveau concept, le Meuble Plus, un espace pas très grand dans lequel vous occupez une fonction dédiée. Un espace de vie qui correspond à une maquette de la taille d'une boite à chaussure rectangulaire. Il imaginait que dans le futur, les habitants auraient ce type d'espace, relié à une infrastructure "cloud", "en nuage", qui les connecterai à l'extérieur pour l'électricité, la communication et que la ville peu à peu deviendrait beaucoup plus dispersée, Elle tendrait vers une grande globalité et c'est un peu ce qu'on vit avec la pandémie. Caroline Cros
mardi 5 janvier 2021
Comment les hommes du passé voyaient-ils leur futur
Épisode 1 : Futurs antérieurs, histoire des représentations de l’avenir
 |
| Luigi Russolo, La Rivolta (La Révolte), 1911, huile sur toile. Gemeentemuseum, Den Haag, La Haye. |
Nous représentons-nous l'avenir de la même manière que nos ancêtres ? Assurément non : notre conception du futur a beaucoup à voir avec notre présent, nos inquiétudes et nos espoirs contemporains, mais aussi avec notre histoire. Alors, quels points communs entre les futurs d'hier et d'aujourd'hui ?
Le poète Georges Brassens nous avait prévenus : « Il est morne, il est taciturne / Il préside aux choses du temps / Il porte un joli nom, Saturne / Mais c'est dieu fort inquiétant ». Chez les Romains, Saturne est le maître du temps, identifié au titan Cronos, chez les Grecs. Ah ! le temps, quelle chose complexe. Il y a le passé, le présent, le futur, mais nos ancêtres avaient aussi leur passé – qui est aussi le nôtre –, leur présent – qui est notre passé –, et leur propre futur, qui est aussi notre passé. « Il faudra que Saturne en fasse / Des tours d'horloge, de sablier », rappelait avec justesse Brassens. Sans conteste, Saturne est un dieu fort inquiétant. Xavier Mauduit
Depuis le début de la crise sanitaire, il est devenu difficile de se projeter dans l’avenir : qui peut dire ce qu’il fera dans deux semaines, trois mois ou un an ? À l’aube de l’année 2021, cette suspension du cours habituel du temps et de la vie est aussi le moment propice à une réflexion sur notre rapport à l’avenir.
Le futur tel que le pensaient les Grecs, les premiers chrétiens, les penseurs des Lumières ou nos grands-parents n’a rien à voir avec le futur tel que nous l’envisageons (ou du moins l’envisagions !). Le futur a pu être pensé comme une simple répétition du passé ; comme une fin des temps rédemptrice ; comme un monde meilleur atteignable par le progrès technique ; comme une dystopie cauchemardesque... Il y a donc une histoire de l’avenir, de ses représentations, mais aussi des rapports de force au sein des sociétés pour imposer “sa” vision du futur.
Nous en parlons avec nos invités :
François Hartog, historien spécialiste de l’Antiquité et des formes historiques de temporalisation, membre fondateur de L'Association des Historiens,
François Jarrige, maître de conférences en histoire contemporaine à l’Université de Bourgogne (Centre Georges Chevrier), spécialiste des sociétés industrielles et de l'histoire des techniques.
Ce qui distingue profondément le monde ancien des mondes modernes c'est que le futur n'excédait pas le passé : On était dans un régime d'historicité tel que la catégorie prépondérante était celle du passé. Ce qui veut dire que quand ils imaginaient le futur, quand ils essayaient de le préparer, quand il reprenait une action, ils commençaient par regarder en direction du passé pour y trouver des précédents, des exemples, des instruments pour y conduire leur action (... ) On était dans un univers où les repères demeuraient, c'est ce avec quoi le monde moderne va rompre, mais, dans l'intervalle, il y a eu le surgissement du christianisme. François Hartog
On note deux phénomènes majeurs au tournant du XVIIIe et du XIXe siècle : l'expérience de la révolution politique et l'expérience de la révolution industrielle. Deux transformations fondamentales du rapport au monde qui vont entrainer une transformation du rapport au temps avec l'idée que l'on peut se projeter dans le futur d'une façon enthousiaste, positive et confiante parce que les révolutions politiques entre 1789 jusqu'au milieu du XIXe siècle ont montré aux contemporains que l'ordre social, politique, n'était pas quelque chose d'immuable, de naturel mais était aussi le résultat d'une construction. Il pouvait être modifié, chamboulé par l'intervention des humains. Les révolutions politiques sont parallèles à des périodes de mutations économiques, des transformations des fondements matériel du monde qui vont donner de plus en plus de confiance dans la capacité que les sociétés occidentales ont à modeler leur environnement en contrôlant la nature pour produire de l'abondance qui devient le grand mythe moderne à partir du XIXe siècle. François Jarrige
Rencontre: Nicolas Hulot et Frédéric Lenoir refont le monde
Quand un philosophe rencontre un écologiste, de quoi parlent-ils? De l'état de la planète, de la nature et de sa beauté, mais aussi de notre capacité à nous reprendre en main pour bâtir un monde meilleur. De cette conversation au long cours est né un livre revigorant.
 |
| @Eric Durand |
• Notre Temps: Vous avez chacun plusieurs dizaines de livres à votre actif. Pourquoi avoir choisi d’écrire celui-ci à deux voix?
Frédéric Lenoir: Justement, pour croiser et partager des expériences. Cela a élargi mon point de vue et conforté certaines de mes convictions. Nicolas a beaucoup plus de compétences que moi dans le champ de l’économie et du politique. Moi, j’ai une formation philosophique et sociologique, plus universitaire. Et puis nous avons chacun le projet de participer à un monde plus juste, plus équitable, plus respectueux de la planète, mais nous le faisons à partir d’expériences très différentes.
Nicolas Hulot: Pour moi, un livre, c’est un moment de mise au point. Dans ce monde où nous vivons toujours avec un sentiment d’urgence, il est vertueux de se poser et d’apporter une contribution sur l’origine des crises que nous traversons. L’actuelle a des multiples racines: écologique, sanitaire, économique… C’est surtout une profonde crise de civilisation; il faut essayer d’en comprendre les causes et se mettre en situation d’y apporter des traitements. Ce dialogue croisé m’a permis de les confronter. À titre personnel, ce livre m’a fait du bien.
F.L.: Moi aussi, même si la confrontation avec Nicolas est abrupte, douloureuse… Non, je plaisante! C’était aussi une belle aventure amicale.
• Le sous-titre du livre est "Le Temps des consciences". Depuis trente ans, les réunions et sommets pour la planète se multiplient. Cela a laissé du temps aux consciences de se mobiliser. Pourtant, la situation continue de se dégrader. Comment ne pas se décourager?
F.L.: Les défis sont toujours là, et la réaction des politiques accuse un retard colossal en regard de leur importance. En revanche, et c’est ce qui me rend relativement optimiste, énormément de gens sont en train de prendre conscience de ces enjeux. Dans les ateliers philo que j’anime, les enfants sont extrêmement sensibles à l’état de la nature, au sort des animaux, aux inégalités. Beaucoup d’étudiants ne veulent pas travailler dans des entreprises qui n’ont aucun souci de la société ou de l’environnement. L’économie sociale et solidaire progresse. Il y a une évolution. C’est motivant.
N.H.: Je suis plus inquiet que ne l’est Frédéric, mais je pense qu’il est trop tard pour se résigner. Le monde de demain va de toute façon être impacté par la crise écologique. Il sera très différent de celui d’aujourd’hui et nous avons des marges de manœuvre pour décider que le changement passera de gré ou de force. Je me bats pour que ce soit de gré. La prise de conscience est là. Il y a une énergie sourde qui est en train d’émerger dans notre société en réaction à ce modèle de compétition, de prédation. Et je mise là-dessus. Je me dis qu’à un moment, ces forces vont se rejoindre. Dans une forêt, on entend l’arbre qui tombe et pas les mille autres qui poussent. C’est ce qui me donne de l’espoir.
Vous dites qu’il est difficile de faire bouger les choses dans le cadre de l’exercice du pouvoir politique tant les résistances économiques et mentales sont grandes…
N. H.: On essaye de ne pas avoir une approche simpliste du type "les hommes politiques n’ont rien compris et les acteurs du monde économique sont des grands méchants". La réalité est bien plus complexe. Nous tentons de comprendre pourquoi le discrédit des politiques auprès des citoyens augmente d’année en année. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus dans la démocratie. J’énumère un certain nombre de raisons: l’orthodoxie économique qui fait que, parfois, on ne met pas les moyens qu’on devrait mettre là où il le faudrait. Ensuite, nous n’avons pas de méthode pour accompagner les mutations.
Enfin, le politique est sous la pression du court terme. Les lobbies font peser en permanence la menace des pertes d’emplois pour défendre leurs intérêts. Or, la somme des intérêts particuliers n’a jamais fait l’intérêt général! Au fil du temps, les politiques se sont laissé déposséder de leurs prérogatives par une partie du monde de la finance. Mais à vingt-sept, en Europe, nous pourrions facilement nous redonner des marges de manœuvre. On l’a d’ailleurs vu lors de la crise sanitaire: des milliards ont été trouvés du jour au lendemain! Ce qu’on a su faire en temps de crise, pourquoi ne pas le faire en amont?
• Il faut donc des gêneurs, comme vous, pour sonner la fin de la partie?
N.H.: Oui, vous avez raison, le cercle vertueux, c’est d’avoir des politiques qui soient à l’écoute de ces gêneurs ou lanceurs d’alerte et qui se nourrissent de leurs éclairages. La société civile doit aussi admettre la complexité de l’exercice politique. C’est pourquoi, si on veut revitaliser notre démocratie, je préconise d’associer en permanence les citoyens, à toutes les échelles: locale, régionale et nationale. Les citoyens, électeurs, manifestants, acteurs sociaux et consommateurs, ont voix au chapitre. Nous ne sommes pas dépossédés d’une certaine influence et d’un certain pouvoir. Mais il ne faudrait pas que l’expression populaire prenne une forme violente pour en tirer des leçons. Comme disait Victor Hugo: "Souvent, la foule trahit le peuple."
• Comment, comme vous le préconisez, "passer du toujours plus au mieux-être" dans notre société de consommation et à un moment où le gouvernement nous enjoint de consommer pour relancer l’économie?
F.L.: On est toujours dans la quantité: consommer toujours plus, acheter… Il faut passer au mieux-être et découvrir que ce besoin qu’à l’homme de satisfaire son désir doit s’orienter de plus en plus vers des choses immatérielles plutôt que d’être entièrement focalisé sur des objets matériels. Cette conversion ne peut s’opérer que si l’être humain comprend qu’il a intérêt à le faire. Intérêt sur le plan collectif, pour éviter un chaos environnemental et sociétal, mais aussi intérêt à titre personnel. Tant que l’on n’a pas expérimenté que c’est à travers la beauté, l’amour, la qualité des liens et la vie simple que l’on peut avoir les plus grands moments de joie, on ne peut pas changer.
N.H.: Le gouvernement veut que les épargnants utilisent leur bas de laine. Pourquoi pas, si c’est pour les inciter à rénover leur logement pour économiser l’énergie, à acheter un véhicule électrique, à utiliser des services de relations… Une économie peut ne pas être 100% matérielle. Les gens ont besoin d’aide à domicile, de soutien scolaire… C’est cette économie-là qu’il faut aussi faire repartir. Il y a un plan de relance avec des milliards d’euros: j’y suis favorable dès lors que pas un euro ne va dans quelque chose de toxique. Si l’on soutient certains secteurs économiques, il faut des contreparties. L’argent public ne doit pas servir à aggraver la situation écologique et sociale.
• La résistance au changement est universelle. Vous-mêmes, comment la combattez-vous?
N.H.: Je n’ai pas toujours été écologiste et le suis-je encore complètement? Je demande le droit à l’erreur et parfois à l’imperfection. Mais j’ai arrêté toutes mes addictions liées à la vitesse, au pilotage de toutes sortes d’engins. J’essaye d’être cohérent dans ma consommation: investir dans un chauffe-eau solaire, un récupérateur de pluie… Si je prends une voiture, je tiens compte de son impact écologique, mais cela ne m’empêche pas de sortir de temps en temps ma vieille 2CV. J’ai diminué ma consommation de viande, je ne prends quasiment plus l’avion… C’est un chemin de progression qu’il faut faire en fonction de ses capacités et sans culpabiliser. Je le dis pour ne donner de leçon à personne. De quoi cela m’a-t-il privé? J’avoue que je trouvais très plaisant de piloter un avion ou un hélicoptère. J’étais dans une insouciance totale à l’époque. Suis-je moins heureux, maintenant, à faire du kitesurf ? Non, j’ai trouvé d’autres formes de plaisir.
F.L.: Le plus difficile pour moi est lié à l’alimentation. J’ai pris des résolutions de ne manger que local, le plus bio possible, de ne pas acheter des choses emballées dans du plastique, de diminuer ma consommation de viande… Mais j’y arrive plus ou moins. Parfois, pour des raisons pratiques, je ne fais pas 15 kilomètres de plus pour aller au magasin bio. Je vais au supermarché du coin et je me retrouve avec des aliments dont je ne connais pas la traçabilité et qui ne correspondent pas aux critères que je me suis fixés. Je progresse, mais lentement. Il m’arrive d’acheter des fraises en hiver… Et je me dis que c’est complètement aberrant.
N.H.: Ce qui est difficile dans le changement, c’est de briser les automatismes, les comportements réflexes. Une fois qu’on y est parvenu, il y a un sentiment de liberté, comme quelqu’un qui parvient à arrêter de fumer. Et cela vous rend heureux!
• Une chose frappe, à la lecture de vos entretiens, c’est l’expérience quasi mystique de la nature qui vous réunit…
N.H.: Je ne sais pas si le divin existe mais, en tout cas, je vois dans cette nature tant d’ingéniosité, de grâce, de malice, que cela ne peut pas être simplement le fruit du hasard. J’ai vu la beauté à 2000 mètres sous les océans, dans les pétales d’une rose ou sur le dos d’une coccinelle. Je ne fais pas d’ésotérisme et de métaphysique, mais ça rend humble. Je pense aussi que cette beauté est un langage universel qui nous relie.
F.L.: Oui, ça nous relie et ça ouvre le cœur. La relation à la nature est une expérience d’amour. On se sent ému, bouleversé. Vous avez raison de parler d’expérience mystique: face à la beauté de la nature, on fait le constat que quelque chose nous dépasse. Sa complexité, son ordre extraordinaire et son harmonie sont source d’émerveillement et de contemplation. L’un et l’autre, nous avons cette dimension contemplative très forte. Nous sommes nourris par la splendeur du monde! Nous avons la chance de pouvoir vivre au contact de la nature. Contrairement à Nicolas, j’ai pour ma part un chemin plus relié aux religions avec la découverte du Christ et des évangiles qui m’a bouleversé quand j’étais jeune adulte. Il reste qu’aller marcher en montagne, regarder la mer… sont les grands moments d’émotion que je ressens aujourd’hui.
• Les jeunes sont souvent aux avant-postes du combat en faveur du climat. Avec la formule "OK boomer", on a senti que certains faisaient porter aux plus âgés la responsabilité du réchauffement climatique. Selon vous, y a-t-il là un risque d’opposition, voire de rupture générationnelle?
N.H.: La responsabilité s’érige à partir du moment où l’on a la conscience des choses. On ne peut pas nous rendre responsables des comportements que nous avions quand nous étions des consommateurs insouciants, instrumentalisés par la publicité. Maintenant, nous sommes abreuvés d’informations qui nous mettent face aux conséquences de nos actes. À partir de là, nous engageons notre responsabilité. Mais cette rupture dont vous parlez, je la redoute: attention qu’un jour, nos enfants ne nous détestent pas! Et je dis aux adultes qui les regardent manifester avec une certaine condescendance: écoutez-les, entendez-les, parce que, sinon, leurs craintes, leurs espoirs et leurs revendications pourraient prendre une autre forme…
F.l.: En même temps, ce qu’on observe chez les jeunes est plutôt encourageant. Évidemment, il y en a, pris dans le système, qui veulent toujours avoir le plus beau smartphone, des marques… Mais on voit aussi un certain nombre d’entre eux qui semblent, par leurs comportements, vouloir s’éloigner de leurs aînés, en arrêtant de manger de la viande, par exemple, et qui ont une conscience écologique très affirmée. Ils ont une pratique plus radicale que nous. Cela dit, il est inutile de se culpabiliser d’avoir beaucoup consommé pendant trente ou quarante ans. On ne savait pas… Mais maintenant, cela vaut le coup de corriger le tir.
le 04 janvier 2021 à 11h20 par Marie Auffret et Jean-Christophe Martineau